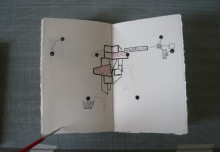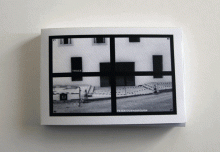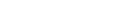J’ai d’abord vu couler l’Agly, sur les rives débordantes de laquelle j’ai passé une bonne partie de mon enfance.
Plus tard, j’ai vu couler le Rhin, la Vistule, la Neva et le Mississipi.
J’ai même vu couler le Neckar, cher à quelques poètes et philosophes allemands qui ont troublé ma jeunesse et dont on fait aujourd’hui les précurseurs du nazisme.
Mais je n’ai jamais vu couler la Meuse, qui est pour moi un fleuve aussi mythique que l’Orénoque.
La Meuse. Maas en néerlandais.
Richard Meier, lui, vient de là, des bords de ces eaux lointaines et qu’on imagine ici toujours boueuses, très mélancoliques.
Ce personnage – assez énigmatique au départ – est exactement ce qu’il manquait à notre pays pour parfaire son identité. Car il apporte à celui-ci le supplément de modernité qui lui faisait défaut. Il y a beaucoup d’artistes chez nous mais il n’y avait pas jusqu’ici d’expérimentateur. Et Meier, artiste par ailleurs, justement en est un, faisant se confronter l’universel et le local dans une perspective qui raconte l’architecture du monde depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte.
Assez énigmatique en effet.
Je me souviens de son dernier voyage à Paris.
A son retour, je lui demande : « Qu’est-ce que tu es allé faire là-bas ? »
Et il me répond tranquillement : « J’ai rencontré rue de Lisbonne un congolais avec sa bonne ».
Ce qui m’a privé pendant un an de lui poser une autre question.
Qui es-tu donc, Richard Meier ?
Je l’ai toujours connu penché sur ses instruments de travail – travailler, produire – comme si pas un jour de
détente, à l’exception de quelques balades matinales sur le sable autour du bocal du Tech.
Ce qui m’a toujours fait considérer ma paresse comme monstrueuse, déplacée, à l’heure où je multiplie les
siestes.
Quoique vivant avec une authentique catalane (et ayant fait une partie de ses études des Beaux Arts à
Montpellier), Richard Meier, né sur les bords de la Meuse, n’est pas d’ici et c’est parce qu’il vient d’ailleurs – si loin des eucalyptus – qu’il ne cesse d’enrichir ce pays.
Voir d’urgence l’ensemble de ses peintures, de ses livres et de ses carnets.
Adolescent, j’ai toujours rêvé d’aimer une nordique, une fille aux cheveux blonds nature (comme beaucoup de femmes d’ici, ma mère teignait les siens, ce qui me gênait).
Ils habitent un mas ombragé par de vieux platanes à quelques kilomètres d’Elne ; la profondeur de la lumière joue sur les troncs boursouflés, abimés peut-être par une maladie. Le dernier étage est occupé par l’atelier de Richard, son laboratoire. De grosses machines (grosses à mes yeux) lui permettent de fabriquer lui même ses livres. Il y a un jardin devant la maison. Et il y a des chats qui montent et descendent les escaliers.
L’immédiate intimité que crée l’odeur du jasmin dès qu’on l’effleure, voilà ce que j’ai ressenti la première fois que je suis allé chez eux. Mais on m’a dit plus tard qu’il n’y avait pas de jasmin dans ce jardin.
Les gens qui viennent d’ailleurs sont toujours une énigme pour les catalans qui ont de la difficulté à imaginer qu’on puisse vivre hors de leurs frontières.
Meier ne se contente pas d’être un passeur, il transforme tout ce qu’il touche et il touche des masses de choses, il est lui-même masse, radicalité, totalité : livres, peintures et carnets, dont l’ensemble – blocs de textes, blocs d’images – devient une fiction qui, depuis les bords de Meuse, oscille entre l’intime et le dehors.
Pouchkine écrivait à un de ses amis, un garçon sérieux mais qui n’avait pas le sens de la modernité : « Tu ne seras pas celui qui écrit la lettre mais tu seras le facteur. »
Richard est à la fois celui qui écrit la lettre et le facteur.
On me dit que Meier – ici connu d’abord sous l’appellation de VOIX éditions – revient à la peinture.
Donc retour à la toile, à la pratique du tableau, d’où la présence indispensable du mur.
Mais je crois pourtant qu’en faisant ce qu’il a fait, des livres par exemple, et en oubliant le pinceau, Meier n’a
jamais cessé de peindre, il a seulement transformé la peinture en phénomène optique. Son œuvre est unique justement parce qu’elle ne distingue pas l’éditeur de l’artiste car l’éditeur est d’abord un artiste. Et un artiste qui est aussi un danseur (on danse beaucoup dans les carnets). Meier ne sort de chez lui que pour se confronter, se ressourcer au travail des autres, qu’il encourage, nous offrant cette « possibilité miraculeuse de sortir de la petite vie » (Maurice Nadeau).
A l’aide de la truelle ou du couteau, il trace aujourd’hui des lignes verticales sur la toile, le tableau est déjà là, il suffit de l’achever.
Richard est un homme des extrêmes, un homme des frontières : la même distance le sépare aujourd’hui de l’Espagne et de la Catalogne sud qu’autrefois – du temps de la Meuse – de l’Allemagne, du Luxembourg et de la Belgique.
J’aime les antipodes : ciels de western et ciels mouillés, ciels brouillés.
Ici, vers le soir, le ciel est rouge brique : entre deux boules blanches de nuages, ça zèbre là-haut comme des prunes déchiquetées. Mais on peut aussi aimer la pluie. Mon ami Franck Venaille, qui ne jure que par la Belgique et l’Escaut, trouve que le soleil a quelque chose de sinistre dans sa permanence.
Présence constante de l’enfant Meier dans les carnets. Et moi j’ai toujours cherché l’enfant dans un nouvel ami. Malgré mon âge, je continue d’accumuler, à chaque rencontre, les amis d’enfance. Ici l’enfant proche de sa sœur, peintre naïf, l’enfant qui suivait à pied le cours de la Meuse jusqu’aux neufs arches de Maastricht
(Meier = Mais hier), comme j’aurais aimé l’accompagner, peut-être y aurais-je trouvé ma jeune fille nordique aux cheveux blonds nature, qui manque tellement à mes souvenirs.
Car le Sud parfois m’épuise, me paralyse, m’exaspère.
Plus doux, plus modeste, plus humain et plus hospitalier, le Nord m’apaise et régularise mes fonctions.
Je ne sais pas ce qui fait le plus de fous, si c’est le Sud ou le Nord. En tout cas, j’ai besoin de la folie calme,
silencieuse et quasi invisible de ces gens-là.
Cette folie que je retrouve parfois chez Richard Meier. Folie douce qui s’apparente un peu, pour nous qui
sommes d’ici, à de l’ascèse, à du détachement (la Rhénanie et Maître Eckart ne sont pas loin).
J’ai écrit un jour à Claude Massé : intranquillité des gens qui comme moi ont un jour hésité entre le Sud et le Nord, ignorant que les frontières n’existent plus, ce qui n’empêche pas qu’on reste pour l’éternité le sudiste ou le
nordiste de quelqu’un.
J’en ai marre des va-et-vient et des extrêmes. Entre le désert et la glace, je voudrais trouver un centre, me fixer et
qu’on me foute définitivement la paix pour qu’enfin je puisse goûter à l’amour partagé et aux multiples plaisirs de la vie. Folie des carnets de Richard Meier. 70 carnets, 5OOO pages. Tout y est, de l’enfance à l’âge adulte. Pas une ébauche, comme dans les carnets de Valery, non, une œuvre complète, des dessins, des textes, une organisation de l’espace, avec des trous dans le papier qui sont autant d’électrochocs pour ponctuer l’ensemble, et la Meuse toujours présente, aplatie ou bien qui se dresse comme une statue, la Meuse tout au long de son cours, jusqu’à Rotterdam, la
Meuse qui passe devant toutes les églises de Maastricht.
La Meuse. Maas en néerlandais, qui veut dire mesure.
(Ce fleuve qui, répétitivement, revient sous ma plume quand j’écris ces lignes au point de le faire mien – moi qui suis d’Agly -, alors même qu’en fait Richard a vu le jour en bord de Moselle et que la Meuse n’est pour la plupart des mosellans qu’un non-lieu, une voisine approximative, une sorte de fantasme, des eaux traversant un paysage sans vie, désertique, fictionnel, comme l’était, au début de l’autre siècle, le département de l’Aude pour mes grands parents, l’Aude – aujourd’hui largement réhabilitée – par laquelle il fallait nécessairement passer, et très vite, pour aller d’ici vers le nord, c’est à dire vers l’étranger, no man’s land, territoire hostile et désolé, envahi l’été par les moustiques, ces insectes qui avaient complètement saboté la nuit de noces à Narbonne de l’une de mes grand-mères, native de Poussan les Oulettes).
Quant à moi, que je le veuille ou pas, que ça me plaise ou pas, je suis d’ici, j’appartiens à ce pays, ce qui limite quand même mes désirs et mes ambitions, à supposer qu’il m’en reste encore.
Il ne m’a servi à rien, pendant plus de quarante ans, de traverser le monde, car je n’y ai rien trouvé que je ne trouve ici, même s’il m’est arrivé de m’amuser.
Ce pays dans sa géographie – le Sud, une plaine, une mer, une frontière, des montagnes – est admirable.
Pourtant j’ai voulu partir pour rencontrer des gens qui ne me ressemblaient pas (mais c’est ici que j’ai rencontré Richard Meier, qui, lui, devait accomplir le chemin inverse), pour rencontrer des filles qui ne ressemblaient pas à celles qui m’étaient peut-être destinées mais que je trouvais trop musclées ( ?) et trop bien pensantes à l’époque (alors qu’un grand oncle me serinait que les filles qui ont de la religion sont plus ferventes au lit que celles qui n’en ont pas).
Maintenant que je suis un homme du passé, ce sont des hommes comme Meier qui, dans le silence de pierre qui parfois nous entoure et sachant que la vie telle qu’elle est ne suffit pas, me font croire à l’avenir : voir notamment les carnets et leurs fulgurances à la Mondrian.
Il me semble que Meier, au moins dans son travail, s’est à la longue débarrassé de ses racines alors que je suis totalement prisonnier des miennes : la guerre d’Espagne par exemple (1936/1939) continue de m’obséder comme si j’avais été l’un de ses soldats et comme si elle n’était pas terminée.
Je me suis parfois demandé si, venu de l’Est, Meier ne risquait pas, dans ce pays, l’engourdissement, voire l’étouffement
Mais Meier n’a jamais chercher à faire son trou, c’est un homme-monde et c’est avec l’univers qu’il dialogue à travers ses livres, travaillant avec John Cage, Matthieu Messagier (qu’il illustre), Albert Merz, Lucebert, Gao Xingjian. Et qu’importe l’endroit pourvu qu’on y soit libre.
Refusant aujourd’hui de saborder son travail de peinture par la contrainte de l’édition, Meier expose aussi ses toiles.
Toujours aussi énigmatique, Richard nous confie que, dans une prochaine étape, il voudrait « mettre un mur sur le mur ».
J’essaie de comprendre ce qu’il veut dire. Attendons.
Claude Delmas